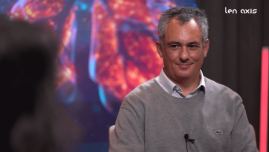Publié le 30 avr 2025Lecture 4 min
CPLF 2025 - L’arrivée des biothérapies dans la BPCO
Hélène JOUBERT, d’après la session intitulée « Biothérapies : la multiplicité des options dans l’asthme va-t-elle se reproduire dans la BPCO ? »

Plusieurs biothérapies, d’abord développées pour l’asthme sévère en ciblant l’inflammation de type 2, pourraient aussi être utiles dans la BPCO. Certains patients, avec un profil éosinophilique marqué et des exacerbations fréquentes, pourraient ainsi en bénéficier. Le dupilumab a obtenu fin 2024 une extension d’AMM dans ce contexte et d’autres traitements, comme les inhibiteurs de l’IL-5 ou les anti-alarmines, sont sur les rangs.
La BPCO touche environ 3,5 millions de personnes en France. Si les traitements actuels sont efficaces (corticoïdes inhalés, bronchodilatateurs de longue durée d’action, vaccinations, réhabilitation respiratoire...), certains patients ne peuvent s’en contenter, conservant d’importants symptômes quotidiens, et/ou des exacerbations. Chez ces derniers, la question de l’utilisation de traitements anti-inflammatoires puissants se pose. Parmi eux, un certain nombre de biothérapies ont été initialement développées pour l’asthme, notamment celles ciblant l’inflammation de type 2 (T2), mais aussi les anti-alarmines, qui pourraient avoir un effet bénéfique dans la BPCO. Ce concept n’est pas nouveau : il y a sept à huit ans, les premières études de phase 3 ont évalué les anti-IL-5 dans cette indication. Les premiers résultats décevants avec le mepolizumab et le benralizumab seraient dus à une sélection inappropriée des patients.
LE DUPILUMAB MONTRE LA VOIE
Ces dernières années, deux études de phase 3 ont évalué le dupilumab, qui bloque le récepteur commun à l’interleukine -4 et à l’interleukine -13, médiateurs clés de l’inflammation de type 2. Les essais concernaient des patients sous trithérapie inhalée, souffrant d’une toux productive persistante et ayant présenté au moins deux exacerbations modérées l’année précédente, ou une exacerbation sévère nécessitant une hospitalisation. Ils avaient tous un taux d’éosinophiles sanguins d’au moins 300 cellules/mm3, sans pour autant être asthmatiques. Le premier essai publié en 2023 a montré une réduction d’environ 30 % des exacerbations modérées à sévères(1). Le second essai de phase 3 contre placebo, NOTUS, publié en mai 2024, a confirmé l’efficacité du dupilumab chez les patients atteints de BPCO avec inflammation T2 et un taux élevé d’éosinophiles sanguins. Par rapport au placebo, il réduit le nombre d’exacerbations (rapport des taux : 0,66 [IC95% : 0,54-0,82], p < 0,001) et améliore la fonction pulmonaire(2). Dans la foulée de ces parutions, l’extension d’AMM a été accordée et la commission de transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) a émis un avis favorable au remboursement du dupilumab, pour cette sous-population en septembre 2024. Le dupilumab (300 mg) est donc indiqué aujourd’hui en traitement de fond additionnel de la BPCO, avec taux élevé d’éosinophiles sanguins, chez les adultes insuffisamment contrôlés par une trithérapie inhalée (corticoïdes inhalés, bêta-2-agonistes et antagonistes muscariniques de longue durée d’action [LABA/LAMA]) ou par une association LABA/LAMA seule lorsque les corticoïdes inhalés ne sont pas adaptés. Au total, environ 38 000 patients pourraient être éligibles au dupilumab, selon la HAS.
UNE DEUXIÈME CHANCE POUR LES ANTI-IL-5
Ces avancées ont conduit à une réévaluation des anti-IL-5, dans des populations de patients BPCO hyperéosinophiliques. L’étude de phase 3 MATINEE sur le mépolizumab a montré des résultats positifs, et une étude similaire est en cours avec le benralizumab (essai RESOLUTE). Les recherches avancent également du côté des anti-alarmines, notamment les inhibiteurs de l’interleukine -33 (IL-33), tels que l’itépékimab et le tozorakimab, dans le cadre de phases 3. L’astégolimab, anticorps monoclonal ciblant le récepteur ST2 de l’IL-33, a été évalué dans l’essai de phase 2a COPD- ST2OP, qui n’a pas montré de réduction des exacerbations. Un essai de phase 3 est en cours, avec des résultats attendus fin 2025. Ces essais devraient tous aboutir d’ici 2025-2026. Enfin, d’autres approches ciblent la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP) avec le tézépélumab, un anticorps monoclonal déjà utilisé dans l’asthme sévère. L’essai de phase 2a COURSE n’a pas montré de bénéfice sur la réduction des exacerbations de la BPCO, mais une analyse selon le taux d’éosinophiles sanguins est en cours.
Si l’essor des biothérapies dans la BPCO est enthousiasmant, ces traitements restent destinés aux patients hyperéosinophiliques, qui continuent de présenter des exacerbations malgré les traitements inhalés habituels et les approches non médicamenteuses.
D’après la session intitulée « Biothérapies : la multiplicité des options dans l’asthme va-t-elle se reproduire dans la BPCO ? », par le Pr Pierre-Régis Burgel (hôpital Cochin, APHP), CPLF 2025
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :